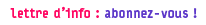Partie précédente : Résumé d’un film non-résumable
Rivette avait pensé que l’expression « aller en bateau » évoquerait immanquablement « partir en voyage », « se faire un trip », plus précisément un trip au LSD, mais ce n’est pas seulement un petit bonbon fluorescent qui provoque le voyage dans l’imaginaire. C’est l’ensemble du film qui se présente comme un « fantasme total » (total fantasy). Les rues de Paris par exemple sont tournées de manière à mettre en valeur les aspects fantasmatiques (the fantasy aspects) de la relation entre Céline et Julie. Le sous-titre du film est Phantom Ladies over Paris, et la mise en scène fait de Paris un paysage fantasmatique (fantasy landscape). Réalisme, fantaisie, parodie, critique sociale : tout est mis sur le même plan, chaque élément pèse d’un poids dramatique égal. À aucun moment le film ne vient appuyer, souligner, ou indiquer : « Maintenant, nous passons à ceci… ». L’élément documentaire, dans les scènes de rue, est lui-même transfiguré de manière « surréaliste ». Quand Julie s’assoit dans le parc pour lire son livre de magie, par exemple, le vent souffle dans les arbres comme pour signaler une présence mystérieuse, et un chat solitaire passe sur un banc en anticipant la trajectoire que Céline. Rivette travaille aussi constamment le fond sonore pour en faire un élément « théâtral » – les voitures par exemple font un bruit anormalement fort, tout comme les lunettes de Julie quand elle les plie.
Dans ces séquences, à l’opposé du style classique du mélodrame de « la grande maison », la composition et le cadrage sont tellement variés et ouverts que nous nous sommes presque mi-se-s au défi de prédire à chaque instant ce qui va se passer en termes de composition visuelle. Dans la séquence de la poursuite, par exemple, chaque plan offre une perspective et un point de fuite différents. Les bâtiments apparaissent dans des dimensions changeantes en arrière-plan, car il y a une grande variété d’angles dans la prise de vue et dans la façon dont les personnages se déplacent. Une séquence de poursuite obéit en général à une certaine unité visuelle : une répétition, une continuité dans les dimensions, une alternance fixe et régulière entre les plans sur le poursuivant et les plans sur le poursuivi. Ici les deux protagonistes de la poursuite s’asseyent sur un banc, s’apostrophent, flânent dans un marché parisien (où Céline pique une pomme), et chacune fait savoir à l’autre qu’elle sait ce qui se passe : Céline a vu Julie la suivre, et Julie a vu que Céline l’avait vue. Quand elles arrivent sur la Butte Montmartre, Céline prend le funiculaire tandis que Julie emprunte les escaliers. Elles ralentissent et accélèrent, se cognent l’une à l’autre, s’interpellent, et la poursuite se termine avec Céline à sa fenêtre, dans sa chambre d’hôtel, observant sa poursuivante qui arpente la rue en contrebas. Ce caractère ouvert et non-linéaire de la mise en scène produit une nouvelle forme, particulièrement appropriée pour montrer une « chasse » entre femmes – parce qu’il n’y a pas de répartition des rôles fixée à l’avance entre ces deux femmes, comme il y en aurait dans une poursuite hétérosexuelle (de la femme par l’homme).
Lorsque Céline et Julie sucent leurs bonbons, s’assoient sur leur malle et fixent la caméra, elles donnent une double impression : qu’elles contemplent leurs propres « visions » d’une part, et d’autre part qu’elles nous regardent, nous spectatrices ou spectateurs. Spectateurs ou spectatrices comme elles, nous suivons le même chemin qu’elles – à commencer par la fascination devant l’histoire de « l’autre maison », avec ces adultes qui se manipulent les uns les autres. Puis la durée du film, ainsi que la répétition des mêmes plans et des mêmes répliques, dissipe les effets de fascination, et finalement nous voyons les deux spectatrices apprendre à se moquer du mélodrame, et à surmonter le processus d’envoûtement dans lequel il est censé nous entraîner d’ordinaire. Les histoires mélodramatiques, les mythologies de l’Amour hétérosexuel, la quête de l’Homme idéal, l’amour tragique, la politique dévastatrice de la famille traditionnelle, tout cela est désormais saisi comme un tout cohérent [3] – et sans doute tout cela est-il réellement relié, d’une manière différente, dans la vie réelle de chaque femme.
Le mélodrame de « la grande maison » dans laquelle Céline et Julie reviennent faire des incursions n’est en fait rien d’autre que le fantasme masochiste féminin (masochistic feminine fantasy) : cette triste histoire de domination et de soumission qui s’origine dans la famille traditionnelle, et dans laquelle tout tourne autour du pouvoir masculin. Dans cet imaginaire, l’enfant est supprimé : l’enfant au sens propre (ici la petite Madlyn), éliminé-e de la famille, mais aussi la part d’enfance éradiquée de la personnalité de ces adultes desséchés. Ce scénario réactive des représentations qui structurent le genre du mélodrame depuis deux-cents ans, et qui se perpétuent aujourd’hui dans des feuilletons télévisés : des femmes s’affrontent pour un homme, et pour le confort bourgeois qu’il peut leur apporter.
Le fait que Céline et Julie se fassent leur trip final à deux peut être considéré comme une décision consciente de se soutenir au sein d’un univers fantasmatique qu’elles savent destructeur (a fantasy they know is destructive). Comme tant de femmes, au moment crucial, elles ont peur de se faire prendre et de se faire punir. Mais quand elles se rendent dans la grande maison pour la dernière fois, cette fois-ci avec l’objectif précis de sauver la petite Madlyn, elles retrouvent les figures mélodramatiques désormais sans vie, incapables de réagir à leur présence, incapables de faire un mouvement en dehors de leur partition déjà écrite. La famille et l’homme n’ayant dès lors plus aucun pouvoir sur elles, Céline et Julie peuvent s’extraire de la maison maudite – et partir vers la lumière du soleil et la spontanéité.
Les femmes hétérosexuelles savent le rôle que joue ce fantasme masochiste dans leur vie intime. Peut-être serait-il plus juste de parler de représentations imaginaires (fantasies) dans lesquelles nous internalisons notre oppression, en particulier notre oppression sexuelle. Ces représentations font partie de la mécanique qui pousse une femme à continuer de dormir avec son oppresseur. Mais le film ne nous montre pas simplement un fantasme mortifère, que deux héroïnes finissent par démolir. Le plus important est l’aventure extérieure qui se joue en même temps que l’aventure intérieure de la maison maudite : un jeu de voeux et d’accomplissement (a wish-fulfill fantasy) entre deux femmes imaginant des manières de se connecter l’une à l’autre et de s’inventer une intimité.
Quelles sont ces inventions ? Les deux héroïnes s’en sortent financièrement. Toutes deux travaillant « dans le symbolique ». Julie la bibliothécaire est le stéréotype de la « vieille fille timide et coincée », tandis que Céline, performeuse dans un cabaret de seconde zone, correspond à un autre stéréotype : la « Bohémienne », « l’oiseau blessé », la perdante, comme a pu l’incarner Liza Minelli. Le fait qu’une femme poursuive activement l’autre dans un rituel de parade nuptiale ou de chasse amoureuse (dans la séquence de course-poursuite du début) est plutôt, dans la vie réelle, quelque chose d’improbable (avec l’essor du mouvement lesbien, les femmes se sont senties libres d’explorer de nouveaux modes de relation, plutôt que rejouer des schémas patriarcaux). Les séquences d’ouverture développent en fait un fantasme qui est à la fois sexuel et social (both a sexual and a class fantasy) : le fantasme d’inversion des rôles. La bibliothécaire, issue de la classe moyenne, « ramasse » et « sauve » une « pauvre petite orpheline ». L’enfant de la rue est prise en main par une « gentille » figure maternelle – tout cela sur fond d’attirance réciproque. Avec ce fantasme qui ouvre le film, les barrières de classe sont abattues, ou du moins prises d’assaut, ce qui rend possible la sororité.
Mais le film ne se focalise pas uniquement sur la sexualité. Il explore aussi l’intime, le jeu et l’audace. Les deux femmes sont physiquement « bien » l’une avec l’autre, qu’elles se prélassent dans l’appartement ou partent en vadrouille, en développant un « langage corporel de filles », et chacune des deux héroïnes trouve une occasion d’entrer dans la vie de l’autre pour la chambouler en démolissant un rôle social potentiellement étouffant – et compromettant pour leur relation (Céline en écartant le fiancé « Gilou », Julie en rembarrant l’impresario et les producteurs libanais).
Les distinctions traditionnelles sont abolies : souvenirs de films, rêves et fantasmes sexuels, tout est mis sur le même plan – de Julie tirant les cartes de Tarot avec sa collègue de travail aux tours de magie de Céline, jusqu’à la soudaine réapparition de Poupie, la bonne vieille nounou de Julie qui lui prépare à nouveau son goûter. Ce « mélange » est constant, tout au long du film. Il y a beaucoup de choses que nous avons été conditionnées à réprimer dès notre plus jeune âge, auxquelles nous avons cessé d’accorder du sens, en particulier tout ce qui se rapporte aux rêves, aux fantasmes, ou à la croyance enfantine dans la magie : Céline et Julie, à travers le jeu, ramène ces éléments à un plus haut niveau de sérieux, d’importance, de signification.
À l’heure qu’il est, ce type d’exercice spirituel n’est pris en charge que par des personnages féminins. Les « gars » vivent leurs aventures dans le monde extérieur, Céline et Julie ont une aventure intérieure, une aventure mentale. Elles entreprennent ensemble un voyage dans les profondeurs douloureuses de leurs propres fantasmes (fantasies), et leurs « frontières identitaires » sont tellement mobiles, fluides, qu’elles parviennent aisément à s’échanger leurs rôles et leurs identités [4]. Les deux femmes prennent soin l’une de l’autre, elles se soutiennent, elles grandissent ensemble – et cela dans la bonne humeur, en se risquant même à explorer ensemble leurs zones sensibles et obscures.
Quatrième partie : Politiques sexuelles du langage non-verbal