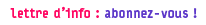Photo de David Binder
Le mot d’ordre récurrent dans le discours de mes enquêtés, notamment dans les réponses recueillies à la première question posée lors des entretiens : « Quand et pourquoi avez-vous emménagé dans le South End ? », est d’abord celui de la diversité. Au-delà du flou qui la caractérise, la notion est très fortement associée à deux thématiques, qui prennent leur source dans deux moments. D’une part la critique de l’urbanisme moderne au début des années 1960, réintégrée dans une rhétorique propre à ceux qu’on appelle les "gentrifieurs", aux Etats-Unis comme en Europe ; et d’autre part la redéfinition idéologique de la gauche américaine au début des années 1990.
Le premier moment conduit à valoriser une diversité conçue comme génératrice de convivialité locale. On retrouve ainsi dans le propos des enquêtés la référence à une diversité qui serait caractéristique des centres-villes. Cette idée, présente dans l’essai célèbre de Jane Jacobs publié en 1961, s’est diffusée par la suite dans les médias, et est devenue un marqueur des résidents des centres requalifiés, comme le montrent de nombreux ouvrages sur la gentrification [1]. The Death and Life of Great American Cities de Jane Jacobs, qui prend pour cible les politiques de rénovation urbaine, dénonce le développement de territoires artificiels et isolés, les suburbs, qui accompagne la disparition des communautés urbaines.
Le propos de l’essayiste est étayé par une description du Village à Manhattan, une communauté pleine de vie, rassemblant dans ses rues et ses commerces des populations différentes et constamment amenées à se croiser et à interagir. L’appréhension de l’espace urbain à laquelle contribue cet ouvrage – tant dans le grand public que dans les métiers de la ville – repose sur une dichotomie forte entre des centres anciens, lieux de convivialité et d’échange, notamment en raison du mélange des populations et de l’animation des rues, et l’uniformité et l’ennui des banlieues, du point de vue de leur urbanisme comme de leur composition sociale. La diffusion de cette littérature, via la contre-culture puis la presse, se ressent dans les propos des enquêtés. Il se traduit aussi dans leurs pratiques puisque, conformément au thème de la rue cher aux gentrifieurs [2], plusieurs membres d’associations de quartier sont actifs dans une organisation fondée en 1990 dans le South End, Walk Boston, qui fait la promotion de l’usage piéton de la ville.
La rhétorique de la mixité sociale institue une distinction forte avec d’une part les quartiers bourgeois centraux de Boston, comme Beacon Hill, et d’autre part les banlieues. L’excitation générée par le South End (décrite à travers le mot anglais vibrant, qui revient sans cesse dans la bouche des enquêtés) est opposée à l’ennui des suburbs, la mixité du premier à l’homogénéité des secondes, la convivialité à l’anonymat [3]. Ainsi, mais après avoir tenu à me faire un long historique du South End en insistant sur l’architecture intérieure des brownstones (« il y a les magnifiques moulures, et les plafonds, et les lustres… »), cette habitante m’explique : « J’aime ce quartier, c’est formidable. Je l’aime parce que les gens se disent bonjour. » Et alors que je lui demande si ce n’est pas le cas dans les banlieues, elle me dit : « Non, et ce n’est pas le cas à Beacon Hill [où elle était propriétaire avant d’acheter une maison dans le South End], ni non plus à Back Bay. […] Je préfère vraiment ici parce que vous pouvez connaître les gens. C’est plus sympa (friendlier). »
L’évocation des voisins que l’on salue dans la rue et qui se gardent leurs clefs est récurrente [4], et toujours opposée à un Beacon Hill trop snob ou trop anonyme. Le terme de « live and let live » (vivre et laisser vivre) est devenu, comme dans le quartier étudié par Elijah Anderson, un « credo » [5].
Cet habitant, également membre d’une association de quartier, explique :
« J’aime le mélange de gens. J’aime l’énergie qu’il y a ici, toutes ces classes d’âge, toutes ces origines ethniques, ces gens d’orientation sexuelle différente. Je trouve ça très énergisant. J’aime ça. Beacon Hill, c’est plus un type de personnes. Et je ne trouve pas que c’est aussi sympa comme groupe. Dans le South End, on rencontre ses voisins. »
Si le goût pour la diversité est particulièrement mis en avant, c’est aussi qu’il vient offrir, là comme dans de nombreux autres quartiers rénovés, une forme de rationalisation de contraintes objectives. La migration dans le South End est en effet une option parmi une gamme de possibles que ressert l’explosion des prix de l’immobilier à partir du milieu des années 1990 à Boston. La valorisation de la mixité sociale vient en rehausser symboliquement la valeur (encore économiquement inférieure à Beacon Hill et Back Bay).
Elle a aussi le pouvoir de faire apparaître la migration comme le résultat d’une personnalité et de goûts singuliers, et donc d’un choix opéré en toute connaissance de cause. Pour autant, la thématique de la diversité se retrouve chez une fraction plus large des classes supérieures, qui peut d’ailleurs habiter dans des quartiers résidentiels précisément incriminés par les résidents du South End, mais qui partage un mode de vie et des positionnements politiques similaires. De fait, il marque plus largement un rapport à l’autre indiquant une refondation majeure de la gauche étasunienne.
Diversité, racisme et euphémisation des exclusions
La lutte des droits civiques introduit une importante fracture dans l’histoire du progressisme étasunien. La radicalisation du Black Power et de la New Left (nouvelle gauche) ainsi que les émeutes de la seconde partie des années 1960 éloignent une fraction de plus en plus importante de la gauche, dépassée par des revendications qui ne prennent plus seulement pour cible la discrimination légale mais les racines structurelles de la pauvreté et de la ségrégation. Bien au-delà de la gauche, le terme white backlash apparu en 1973 désigne la résistance des Blancs à cette formidable remise en cause des fondements de la société américaine et du système démocratique même, dont les liens avec la structure raciale du pays sont désormais dénoncés.
Au cours des années 1970, et plus encore dans les années 1980 avec la présidence de Ronald Reagan, la gauche subit une attaque venant d’une tout autre direction : non plus des radicaux dénonçant son hypocrisie et sa collusion avec le système, mais d’une droite qui va reprendre le vocabulaire même du libéralisme pour dénoncer les dispositifs de lutte contre la ségrégation, supposés remettre en cause l’égalité en instaurant un racisme « à l’envers ». Renonçant à l’idée de suprématie blanche et condamnant explicitement la discrimination raciale, le mouvement néo-conservateur des années 1980 prend pour cible les politiques d’affirmative action (action positive) au nom du principe d’égalité des chances.
La diversité gagne alors en force comme point de ralliement d’une gauche qui fait l’objet d’une attaque idéologique en règle. Dans ce contexte, vivant dans un État réputé progressiste, les Bostoniens apparaissent comme l’incarnation de ces « libéraux » de la côte Est, aussi arrogants que prompts à afficher avec hypocrisie leurs convictions. L’installation dans un quartier mixte est une des manières d’exprimer une résistance à la stigmatisation de la gauche étasunienne telle qu’elle s’est réorganisée pendant les années 1960. La valorisation de la diversité rassemble ce type d’habitants et plus largement certains ménages des classes supérieures de quartiers périphériques dans une posture politique proche.
Quel est exactement le sens de cette « diversité » ? Comme l’a montré Daniel Sabbagh, dès les années 1970, ce paradigme vient se substituer à celui de la compensation dans les justifications juridiques de la discrimination positive [6]. Désormais, les caractéristiques raciales des étudiants peuvent être prises en compte dans leur recrutement si elles contribuent à la « diversité culturelle » de l’université. Par la suite, la notion est reprise dans le monde de l’entreprise, où la diversité est présentée comme source d’une plus grande efficacité. Les catégories concernées s’élargissent, et l’insistance initiale sur la question raciale dans les débats sur l’affirmative action laisse la place à une démultiplication des minorités prises en compte, dont le nombre va devenir lui-même en soi un facteur de diversity [7]. Élu en 1992, le président Clinton ne met pas seulement en avant les Noirs ou les autres membres des minorités ethniques de son administration, mais aussi les femmes et les gays.
Dans le même temps, la problématique des droits civiques tend à décliner dans la classe politique au profit d’une vision plus consensuelle et élitiste des questions minoritaires.
« Clinton a adopté une stratégie prudente, consistant à recruter des minorités et des femmes dans son administration, et même dans les cours fédérales, tout en faisant profil bas sur les droits civiques. […] Durant les années 1990, la diversité a été le grand gagnant. Les démocrates ont compris que, comme tactique politique, promouvoir la diversité était moins risqué que d’approuver l’action positive – la diversité a été redéfinie non pas comme préférence pour les minorités ou les femmes, mais comme un bien commun supposément constitué à partir du potentiel de tous les citoyens [8]. »
Aujourd’hui, dans toutes les déclarations des interviewés du South End, la réponse à la question de la diversité se décline en une succession de catégories, noyant ainsi par le nombre de groupes valorisés, les rapports sociaux qui peuvent opposer riches et pauvres, blancs et noirs, hétérosexuels et homosexuels. Cette diversité, conçue comme un bien commun qui serait favorable à tous sans impliquer une redistribution des places et des rapports de pouvoir, en tout cas dans le South End, s’impose comme mode de légitimation et marqueur identitaire dans les années 1990.
Au début des années 1980, dans les professions de foi des candidats au bureau d’une association de quartier, le mot n’apparaît pas une seule fois alors qu’il est présent sur quasiment tous les sites Internet des associations aujourd’hui. Sur l’un d’entre eux, on parle d’un « coin de Boston qui est riche en histoire, art, architecture et diversité culturelle ». Une consultante que nous retrouverons plus bas raconte :
« On voulait habiter dans un endroit dans la ville qui pouvait apporter ce qu’on considère être le meilleur de la ville, qui est la diversité. Dans toutes ses saveurs, diversité en termes d’âge des gens qui vivent là, le mélange ethnique, l’animation de l’art du South End, les homosexuels, les logements à bas revenus, les jeunes retraités. »
Cette rhétorique permet d’affirmer un certain progressisme tout en diluant la question raciale dans une multitude de catégories qui forment la diversité. Elle a comme vertu de combiner ce que Steven Brint appelle une « culture égalitariste », qu’il s’agit de réaffirmer face à l’offensive néo-conservatrice, avec une « culture ethnique blanche […], largement démocrate mais qui se préoccupe de la criminalité et est hostile à ce qui peut être perçu comme un traitement préférentiel des pauvres et des minorités [9] ».
Ce positionnement se traduit dans le South End par une forte réprobation de la haine raciale, mais qui peut aller de pair avec des préjugés exprimés de manière euphémisée. Significativement, je n’ai entendu de propos ouvertement péjoratifs contre les Noirs qu’à une seule reprise durant mon enquête, chez un couple particulièrement actif dans l’association de quartier : mobilisés contre l’achat de trois immeubles de leur rue par un foyer de sans-logis, Pine Street Inn, ils deviennent d’ailleurs une des cibles de la contre-mobilisation en faveur de la « diversité ».
Lors d’une réunion organisée chez ce couple à laquelle je parviens à me faire inviter, une discussion s’engage sur les résultats scolaires des enfants selon la race des parents : les parents noirs sont décrits comme irresponsables, les parents chinois ou hispaniques sont estimés être plus sérieux. La discussion se déplace sur le rôle de l’histoire et du racisme dans la situation des Noirs aujourd’hui, rôle finalement évalué par les hôtes à 25 % (le désintérêt des parents pour l’éducation faisant partie des 75 % restants). « Il faut arrêter sur le racisme, parce que c’est ça qu’ils veulent entendre », conclut cet avocat. Sans doute désireux de faire comprendre à une étrangère l’ampleur des problèmes sociaux aux États-Unis, le couple poursuit la discussion sur les quartiers noirs de Boston, peuplés à leurs yeux d’une population foncièrement hostile.
Pour appuyer ses propos, la femme, comptable, me raconte cette anecdote. Revenus de vacances, ils passent par Mattapan. Réalisant ce qu’ils considèrent comme une bévue – traverser un quartier noir la nuit en voiture –, elle dit alors à son mari : « Tu peux brûler autant de feux rouges que tu veux, mais ramène-moi à la maison tout de suite ! », et de verrouiller la porte, effrayée par les visages menaçants sur lesquels elle devine les pensées suivantes, me dit-elle : « Qu’est-ce que j’aimerais défoncer ta voiture ! »
L’entretien que j’ai réalisé avec elle l’année précédente avait pourtant commencé d’une façon très classique. Répondant à ma question sur le South End, elle avait vanté son « multiculturalisme ». Pourtant, à la fin de l’entretien, alors que je l’interrogeais sur d’éventuels aspects négatifs du quartier, elle fut plus prolixe sur les questions d’insécurité et sur la présence de Noirs et d’Hispaniques dans la rue. Une anecdote sur des jeunes particulièrement bruyants qu’elle a croisés dans le métro entraîne un long développement sur la responsabilité des parents noirs, et une remarque sur le fait qu’il s’agit « toujours de Noirs. […] Mais on vous traite de raciste quand vous dites ça », concluant toutefois qu’elle a des amis noirs. Durant l’enquête, je n’ai entendu des propos aussi explicites qu’auprès de ce couple. J’y reviendrai dans le dernier chapitre, les clivages raciaux se disent de façon plus subtile, à travers la réprobation de comportements liés à l’alcool et au tabac et aux rapports entre les sexes.
Le couple évoqué ci-dessus exprime sans détour son hostilité à l’aménagement de trois immeubles gérés par Pine Street Inn de l’autre côté de la rue en face de chez eux. Parmi les opposants à PSI, certains tiennent des propos euphémisant, voire niant les clivages sociaux. Ainsi cette habitante, qui s’inquiète de l’arrivée annoncée d’une trentaine de nouveaux locataires lors d’une réunion publique, déclare : « C’est dur pour tout le monde, qu’on ait de l’argent ou pas. » Le couple comme les initiateurs de la première pétition n’hésitent pas à affirmer sans détour la supériorité des propriétaires sur les locataires et à exprimer leur souci de la « densité », utilisant le vocabulaire des associations de banlieue les plus conservatrices. Tel est l’argument principal qui est avancé pour s’élever contre l’achat de trois immeubles et exiger que l’association n’en achète qu’un [10].
Face à cette initiative, cependant, une riposte s’est rapidement organisée. Les défenseurs de la diversité lancent une autre pétition, affirmant le droit de tous, locataires comme propriétaires, à habiter dans le South End.
On peut lire dans cette pétition :
« Nous pensons qu’il est impératif de maintenir et d’augmenter le nombre de logements pour les populations modestes à Boston. Nous voulons vivre dans un South End qui soit, comme il l’a toujours été, un quartier économiquement mixte (an economically diverse community). Nous accueillons donc les résidents de toute origine économique, ethnique, culturelle et sociale, et les invitons à partager la vitalité et la convivialité (vitality and neighborliness) du South End. »
Plusieurs réunions ponctuent les années 2007 et 2008. Des dizaines d’habitants, des conseillers municipaux, un député de l’État ou encore un promoteur immobilier s’y rendent, et communient dans une même dénonciation de l’« égoïsme ». Le refus de la stigmatisation explicite des plus démunis qui se donne ainsi à voir n’est pourtant pas incompatible, nous le verrons plus loin, avec un contrôle strict de la diversité.
Diversité et statut social
Les mutations qui traversent les métiers de l’urbanisme, ainsi que les transformations plus larges du champ politique, éclairent les formes mesurées d’ouverture que représente le goût des résidents fortunés du South End pour les quartiers mixtes. Mais pour comprendre la définition de la diversité qui est la leur, il faut aussi évoquer toute une tradition de l’engagement civique étasunien qui n’est jamais pensée, contrairement à d’autres pays comme la France, comme contradictoire avec les intérêts économiques et commerciaux. La valorisation de la community, loin de se confondre avec l’intérêt général, implique en effet l’affirmation et le respect de chacun de ses composantes. « En aidant les autres, il s’agit aussi de souligner sa position privilégiée au sein de la communauté », écrit Agnès Camus-Vigué dans une comparaison entre le Rotary Club en France et aux États-Unis [11].
Le dévouement à la communauté vient renforcer à la fois symboliquement et matériellement le statut social. Comme le note Michèle Lamont, les bureaux des associations de voisinage, culturelles ou caritatives, sont des lieux de rencontres et d’échanges qui peuvent présenter une certaine rentabilité sur le plan professionnel [12].
Toutefois, si l’engagement civique ne remet pas en cause le statut social, son rendement dans un quartier mixte comme le South End est limité. Les associations locales sont certes des lieux où accumuler du capital, potentiellement reconvertible dans le cadre de mobilités sociales ascendantes et de stratégies sur des niches professionnelles émergentes.
Les marchés ouverts par la gentrification (l’immobilier, les commerces liés aux chiens et la restauration) nécessitent en effet la constitution de réseaux locaux : les associations de quartier en sont un outil. Elles le sont de plus en plus au cours des années 1990 quand l’accès aux listes e-mails devient une ressource en tant que telle : un courriel relatif à un restaurant (qui sponsorise par exemple l’événement d’une association) a le mérite non seulement d’être diffusé auprès d’un nombre important d’habitants fortunés, mais aussi d’apparaître comme une information liée à la vie de la community plutôt que comme une simple annonce commerciale. Il reste que la participation aux associations de quartier donne accès à un capital social qui n’a rien à voir avec celui que procurent les institutions de l’élite bostonienne traditionnelle. Elle n’offre pas, contrairement à la présence dans les conseils d’administration du Boston Symphony Orchestra ou du Museum of Fine Arts, de bénéfice immédiat. Mais pour des résidents des classes moyennes en ascension sociale, elle peut venir compenser l’absence de capital social hérité marquant l’inscription dans une sociabilité bourgeoise. Cet avocat noir arrivé dans le quartier en 1971 peut ainsi, à travers un engagement local dans le South End et dans ses organisations consultatives et caritatives, briguer le statut de notable bostonien.
Des ressources locales dans la construction d’une notabilité improbable
Disposant aujourd’hui d’un revenu de 300 000 dollars par an, Bill Simmons a grandi dans un quartier populaire de New York dans un milieu de classes moyennes. Son père, médecin immigré des Caraïbes, a veillé avec vigilance sur l’éducation de son fils, qui prend la voie des filières scolaires et universitaires les plus prestigieuses. Nouveau venu à Boston, il est noir et, même s’il a une peau très claire, il doit pénétrer un milieu relativement fermé aux minorités ethniques. Il le fait initialement sur la base d’un statut de notable local : membre de son association de quartier, il participe dès son arrivée en 1971 à la plantation d’arbres qu’elle organise et finance. Membre du comité de soutien au maire Kevin White constitué dans le South End en 1975, il est candidat pour les élections de l’organisme de consultation SEPAC et est également membre, depuis 1985, du conseil d’administration du centre social du quartier. Il se calque ainsi, certes à une échelle moins prestigieuse, sur ses collègues habitant en banlieue, qui sont conseillers municipaux ou membre des conseils d’administration des équipements de la ville.
Le passage par une association locale lui permet d’entrer sur la scène municipale de la sociabilité bourgeoise. De sorte qu’aujourd’hui son ancrage dans le secteur associatif s’inscrit dans un éventail d’engagements qui le fait entrer, selon ces termes, dans la catégorie des « usual suspects ». Et pour souligner l’ampleur des obligations que cela représente, insistant ainsi sur la dimension morale de sa personnalité sociale, Bill ajoute cette boutade : « Je dis à ces gens, bon, il y a trois réunions aujourd’hui, j’ai une excuse pour aller seulement à une. Ou alors vous faites juste une apparition, vous passez votre tête, et, “salut”, vous dites “bonjour”, et vous réalisez qu’il y a tout un groupe des mêmes personnes qui font la même chose, avec leur cravate noire. » De fait, son positionnement dans le champ associatif déborde aujourd’hui largement le South End puisqu’il est à la fois membre de plusieurs associations professionnelles et de nombreuses institutions culturelles, qui viennent consacrer, plus définitivement que l’engagement dans une association locale, le statut de notable bostonien.
Les bureaux des associations de quartier, notamment celles situées sur les parties prestigieuses du South End, peuvent apporter des bénéfices plus directs, mais ce n’est le cas que dans la période la plus récente. Surtout, on ne saurait raisonner seulement à travers la grille de lecture, trop étroite, des intérêts économiques. En effet, les carrières à construire ne sont pas seulement professionnelles mais aussi morales. L’adhésion à l’association de quartier, la soumission à ses règles (par la fréquentation plus ou moins fréquente des réunions mais en tout cas des fundraisings) participent à la construction d’une figure morale et c’est le gage donné d’être un « bon voisin ».
L’intrication des intérêts et des désintéressements apparaît clairement dans le cas de la vice-présidente d’une association de quartier, l’une de celles situées sur la section la plus valorisée du South End. À quarante-huit ans, Amy Barber décide de monter sa propre agence de consulting en patrimoine. Cet engagement local est un atout pour rencontrer des clients. Pour autant, l’argent n’est pas sa seule motivation. C’est ce qu’elle m’explique lors de deux entretiens. Le premier a lieu dans la cuisine, aux décorations « provençales », d’une maison dans laquelle je passe, en gravissant les cinq ou six étages, de la salle de gym du rez-de-chaussée au toit aménagé en terrasse. Après que j’ai sollicité un second entretien, Amy me propose très gentiment un autre rendez-vous par e-mail : « S’il fait beau, on peut aller en terrasse à 28 Degrees, où ils ont mes huîtres favorites, 1$ chaque pendant les happy hours. »
Engagement, intérêts et désintéressement d’une consultante
Amy Barber est arrivée dans le South End en 1994, et deux ans plus tard, elle et son mari (sans enfants) achètent une maison dans une des rues situées à proximité du centre-ville. Née en 1958, de père médecin et de mère infirmière, détentrice d’un PhD en économie d’une prestigieuse université de la côte Ouest, elle est consultante en management et en investissement. Son mari est un homme d’affaires, et leurs revenus communs se montent à 500 000 dollars par an. Son goût pour la mixité sociale s’inscrit dans un ensemble de valeurs relativement cohérent. Elle se déclare démocrate, ce qui veut dire qu’elle soutient l’idée d’une redistribution sociale, certes limitée : « Je pense que l’État doit offrir un filet de sécurité aux pauvres. Je pense que les gens doivent être aidés. Je suis pour beaucoup de choses que nous n’avons pas, comme un système de soins, des écoles publiques convenables [mais] pas communiste ! Pas au même degré qu’en Europe. Dans certains endroits d’Europe, ça va trop loin. Les gens vivent du chômage toute leur vie. »
La notion revendiquée de diversité correspond à un ancrage dans le quartier centré sur la fréquentation des restaurants et des salons de manucure, et l’engagement au sein de son association. Ses intérêts ne sont pas circonscrits au South End, et elle souligne à quel point ses amis sont nombreux et dépassent le petit cercle local. Son usage de l’espace résidentiel se combine avec des déplacements et des sociabilités situées à des échelles différentes. Originaire de Californie où elle conserve des liens forts, elle s’est mariée avec un Anglais et va en Europe quatre fois par an : le premier entretien se déroule le lendemain de son retour d’un séjour de ski en France, et ses remarques sur Boston sont ponctuées de comparaison avec Paris ou Londres. Elle mentionne aussi ses visites fréquentes à New York et Washington D.C. Ces multiples références lui permettent de se distancier de Boston, dont la réputation reste, au sein de l’élite blanche éclairée, celle d’une ville provinciale, composée de quartiers enclavés. Elle compare ainsi le South End à un village ou à un quartier parisien, faisant dans le même temps écho, par sa diversité, à un multiculturalisme opposé au caractère trop traditionnel de cette ville de la Nouvelle-Angleterre.
L’accès à des postes de pouvoir au sein de son association de quartier fait écho à des compétences professionnelles aisément reconvertibles dans les activités de fundraising. Amy est sollicitée pour organiser une vente aux enchères : « Je suis extrêmement organisée. Je sais qu’ils m’ont repérée pour ça, pour ces compétences. Je sais comment diriger des équipes censées faire plein de choses. J’avais quinze personnes et je les ai organisées en sous-comités. » Elle prend contact facilement avec les commerçants et les agents immobiliers du quartier, et, au fait des formes d’intérêts réciproques qui les unissent, les sollicite pour obtenir leur soutien, en échange de publicités croisées. On retrouve, dans son discours, l’idée assumée d’une combinaison harmonieuse d’intérêts bien compris. De son engagement dans la community, elle souligne à la fois sa dimension morale mais aussi technique. C’est une véritable compétence, quasi professionnelle, qu’elle met ainsi en œuvre.
Les liens entre son activité professionnelle et son engagement civique se traduisent à un autre niveau, qui montre une économie subtile d’intérêts financiers et de biens symboliques. Comme elle l’explique, son engagement dans l’association de quartier correspond à une volonté de travail non lucratif, à un moment de sa vie où elle et son mari disposent d’une situation financière très confortable : « Nous avons assez d’argent et je veux passer plus de temps à travailler… pas pour de l’argent ! » Il ne s’agit plus seulement de donner 2 % de leurs revenus à des associations caritatives mais de développer un engagement plus ciblé, de trouver une cause dans laquelle elle se reconnaisse.
On voit bien comment cette quête de sens entretient des relations étroites avec sa trajectoire et sa position sociale : en même temps que l’association de quartier, elle décide de rejoindre une ONG de développement qui opère en Amérique latine. Comme ses pratiques de la ville, son engagement se déploie sur des échelles multiples. Elle était partie, étudiante, participer à un projet de développement en Amérique latine. Vingt-cinq ans plus tard, elle écrit à l’ONG et pose sa candidature pour être membre du conseil d’administration, au service duquel elle offre son capital social et financier (elle n’est toutefois pas acceptée et, déçue, compte postuler à nouveau l’année suivante).
De la même manière et en conformité avec l’évolution de son statut et des transformations du secteur associatif, son engagement féministe – même si, suite à ma question, elle hésite à employer le terme, sans doute trop « militant » – subit une forte inflexion. Pendant sa jeunesse, elle a participé à des actions antiblocage pour protéger les cliniques pratiquant l’avortement ; elle apporte aujourd’hui un soutien financier important au Planning familial et à la Ligue nationale pour le droit à l’avortement.
Lire la deuxième partie Les entrepreneurs de diversité.